IDENTIFICATION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Identification des risques psychosociaux
Les Risques Psychosociaux recouvrent essentiellement le stress, le harcèlement (moral et sexuel) et la violence dont les conséquences sur la santé sont plus ou moins graves et différentes selon les individus.
Le contexte social et la vie privée sont des facteurs importants de l'état de santé des salariés mais ce ne sont pas les seuls.
Un niveau de stress élevé peut toucher un agent de guichet même s'il ne craint pas de perdre son emploi, le sur-investissement professionnel et l'excès de stress peuvent épuiser un cadre jusqu'au déséquilibre psychologique et au suicide.
Les risques psychosociaux ont des coûts directs et indirects qui s'estiment notamment en perte de journées de travail et en dépenses de soins de santé.
Section 1 : Le stress
Le terme de « stress » » a été introduit pour la première fois par Hans Selye (1907-1982), médecin endocrinologue autrichien. Pour Selye, le stress est une « réponse non spécifique de l'organisme face à la demande ».
Plusieurs définitions du stress sont proposées par les spécialistes :
- Le stress ou tension nerveuse est le syndrome général d'adaptation. Ce mot signifie contrainte en anglais. Le stress fait partie des troubles psychosociaux.
- Le stress dans la sphère du travail est considéré comme une réponse du travailleur devant les exigences de la situation pour lesquelles il doute de disposer des ressources nécessaires et auxquelles il estime devoir faire face (De Keyser et Hansez, 1996). Cela signifie que :
le stress est un phénomène subjectif : il dépend de l'évaluation faite par le travailleur des contraintes de son environnement de travail ;
le stress est lié au sentiment de contrôle qu'a le travailleur sur son environnement de travail.
- Définition de l'Agence européenne pour la Sécurité et la Santé au travail :
« Un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Bien que le processus d'évaluation des contraintes et des ressources soit d'ordre psychologique, les effets du stress ne sont pas uniquement de nature psychologique. Il affecte également la santé physique, le bien-être et la productivité de la personne qui y est soumise. »
Il est à noter que  l'accord national Interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008 reprend la définition de l'Agence européenne pour la Sécurité et la Santé au travail.
l'accord national Interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008 reprend la définition de l'Agence européenne pour la Sécurité et la Santé au travail.
- Définition du stress du Docteur Patrick Lègeron co-auteur du « Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail » NASSE Philippe, LEGERON Patrick -. Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité – 2008.
« Le stress est la réaction de l'organisme face aux modifications, exigences, contraintes, ou menaces de son environnement, en vue de s'y adapter. »
Le stress se considère à partir du « syndrome général d'adaptation » (SGA) caractérisé par trois phases successives de réactions de l'organisme face à une situation stressante : alarme, résistance et épuisement.
Les trois phases de réaction au stress (source : INRS)
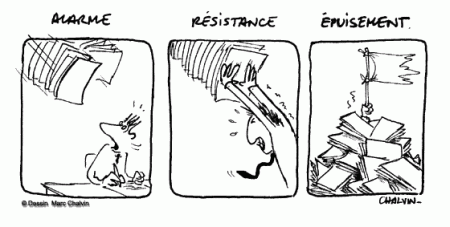
Dossier INRS : le stress
Quelques outils mis à disposition par l'INRS :
« Et s'il y avait du stress dans votre entreprise ? » (ED 973)
« Le stress au travail, le démasquer pour le prévenir. Trois films » (DV0365)
« Stress au travail. Les étapes d'une démarche de prévention » (ED 6011)
« Dépister les risques psychosociaux : des indicateurs pour vous guider » (ED 6012).
Schéma d'une situation de stress selon le modèle de Lazarus et Folkman :
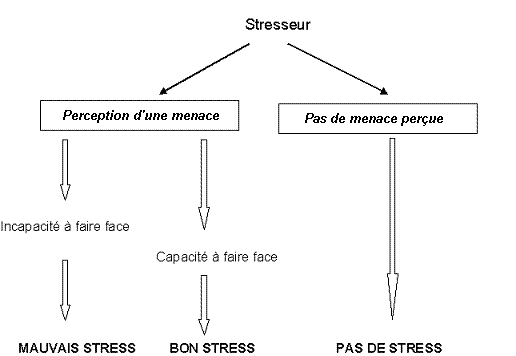
1.1 Les sources du stress
1.1.1 Le stress lié au changement
Le cabinet Stimulus (P. Legeron) estime que 30 à 70 % des changements organisationnels n'atteignent pas leurs objectifs pour des raisons essentiellement liées à l'absence de mise en compte des facteurs humains.
Il énonce les principaux risques de la non prise en compte de la dimension humaine :
Échec total ou partiel du changement
Ralentissement de la mise en place de la nouvelle organisation
Naissance de conflits individuels ou collectifs
Perturbation du climat social
1.1.2 Le stress professionnel
Les principaux stresseurs professionnels :
Les exigences :
Quantité de travail, objectifs, pression du temps, « zapping », complexité...
Les changements :
Menaces, nouveautés, nouvelles technologies, imprévisibilité...
Les frustrations :
Absence de reconnaissances matérielles, sociales ou symbolique...
Les relations interpersonnelles :
Exigences, agressivité, mauvaise communication, conflits, harcèlement.
L'environnement :
Bruit, chaleur, contraintes physiques.
1.1.3 Le stress post-traumatique
Il correspond aux troubles psychologiques qui peuvent apparaître après un événement potentiellement traumatisant, par exemple un accident du travail très grave, voire mortel ou une agression physique violente sur site.
Ces troubles peuvent apparaître au niveau de la personne qui a subi le traumatisme ou au niveau du collectif de travail proche (notamment dans le cas d'un accident mortel).
1.2 Les facteurs de stress en milieu professionnel
1.2.1 Facteurs liés à la tâche ou liés au contenu même du travail à effectuer
Fortes exigences quantitatives (charge de travail, rendement, pression temporelle, masse d'informations à traiter, ...)
Fortes exigences qualitatives (précision, qualité, vigilance, ...)
Caractéristiques de la tâche(monotonie, absence d'autonomie, répétition, fragmentation,...)
Risques inhérents à l'exécution même de la tâche (par exemple : erreur médicale du chirurgien)
1.2.2 Facteurs liés à l'organisation du travail
Absence de contrôle sur la répartition et la planification des tâches dans l'entreprise
Imprécision des missions confiées : Qu'attend-on de moi ? Comment dois-je m'y prendre ? Sur quelle base serai-je évalué(e) ?
Contradiction entre les exigences du poste (Comment faire vite et bien ? Qui dois-je satisfaire : le client ou le respect de quotas ?)
Inadaptation des horaires de travail aux rythmes biologiques, à la vie sociale et familiale
Nouveaux modes d'organisation(flux tendu, polyvalence, ...)
Instabilité des contrats de travail (contrat précaire, sous-traitance...)
1.2.3. Facteurs liés aux relations de travail
Manque d'aide de la part des collègues et/ou des supérieurs hiérarchiques
Management peu participatif, autoritaire, déficient,...
Absence de reconnaissance du travail accompli
La situation professionnelle n'offre pas de perspectives
1.2.4 Facteurs liés à l'environnement physique et technique
Nuisances physiques au poste de travail (bruit, chaleur, humidité, ...)
Mauvaise conception des lieux et/ou postes de travail (manque d'espace, éclairage inadapté,...)
1.2.5 Facteurs liés à l'environnement socio-économique de l'entreprise
Mauvaise santé économique de l'entreprise ou incertitude sur son avenir.
Surenchère à la compétitivité sur le plan national ou international
1.3 Les conséquences du stress sur la santé
Le stress, pour l'individu, peut prendre différentes formes : irritabilité, colère, inquiétude, découragement, diminution des capacités physiques et intellectuelles. Les principaux symptômes sont :
1.3.1 Physiques
Douleurs (maux de tête, douleurs abdominales, douleurs musculaires et articulaires, etc), troubles du sommeil, de l'appétit et de la digestion, sensation d'essoufflement ou d'oppression, sueurs inhabituelles, etc.
1.3.2 Émotionnelles
Sensibilité et nervosité accrues, crises de larmes ou de nerfs, angoisse, excitation, tristesse, sensation de mal-être,
1.3.3 Intellectuelles
Perturbation de la concentration entraînant erreurs et oublis, difficultés à prendre des initiatives ou des décisions.
L'excès de stress se caractérise par :
L'irritabilité et l'impatience
Des problèmes de concentration
Des troubles comportementaux : excès de café, de tabac ou des crises de colère,
Des problèmes physiologiques : hausse de la tension, maux de tête ou maux de ventre, insomnie.
Ces symptômes peuvent se combiner.
(Source : IFAS – Institut Français d'Action sur le Stress).
Si la situation de stress se prolonge, ces symptômes s'installent et s'aggravent entraînant des altérations de la santé qui peuvent devenir irréversibles.
Schéma en couleur Préventique et sécurité Mai-juin 2008. Cliquez ici.
Cliquez ici.
Les conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise
Les conséquences du stress ne pèsent pas seulement sur l'individu en termes de souffrance et de préjudice pour sa santé.
Elles ont également des répercussions organisationnelles et économiques pour les entreprises, et un coût pour la société dans son ensemble.
Le stress au travail désorganise les entreprises et les collectifs de travail. Dans les entreprises où le stress est élevé, on peut ainsi noter :
Une augmentation de l'absentéisme et du turn-over,
Des difficultés pour remplacer le personnel ou recruter de nouveaux employés,
Des accidents du travail,
Une démotivation, une baisse de créativité,
Une dégradation de la productivité, une augmentation des rebuts ou des malfaçons,
Une dégradation du climat social, une mauvaise ambiance de travail,
Des atteintes à l'image de l'entreprise...
Ces dysfonctionnements sont des indicateurs de stress au travail qui peuvent décider l'entreprise à engager une démarche de prévention.
A côté du stress, on distingue les violences internes dont le harcèlement moral et les violences externes, celles provenant de personnes extérieures à l'entreprise, notamment les activités de guichet.
Section 2 : le harcèlement moral
Le harcèlement au travail est un des premiers facteurs du risque psychosocial. Il est défini et interdit par la loi qui oblige l'employeur a une prévention de la santé physique et morale des salariés.
En France, seul le juge peut qualifier une situation de harcèlement moral. Partie juridique Cliquez-ici
Les points clairement définis dans la loi :
« Les agissements répétés » est un des points qui qualifient le harcèlement moral, sans toutefois précision de durée : ce qui suppose d'être à l'écoute et réactif pour identifier les situations de harcèlement moral.
« Les conséquences du harcèlement »
- sur la dégradation des conditions de travail : mise à l'écart, entrave à l'évolution de carrière,
- sur la dégradation de la santé : stress, dépression nerveuse, suicide sont plus ou moins facile à repérer. Le responsable RH ne peut agir seul mais en partenariat avec les acteurs sociaux (médecin du travail, assistante sociale, membres du CHSCT, représentants du personnel...) pour résoudre les dysfonctionnements sociaux.
Ce que la loi précise moins
L'identité du harceleur : c'est, dans la plupart des cas, un supérieur hiérarchique, mais cela peut être également un collègue de travail ou un salarié vis-à-vis de son responsable hiérarchique.
L'intention de nuire : pour engager la responsabilité du harceleur, le Code du travail retient les conséquences, que l'acte soit volontaire ou non.
La nature des agissements : les textes ne précisent pas d'actes prohibés. Cependant, une typologie de certains types de comportement à risques a pu être établie, notamment par Leymann (cf. supra « Quelques repères chronologiques) :
- Empêcher la victime de s'exprimer
- Isoler la victime
- Déconsidérer la victime auprès de ses collègues
- Discréditer la victime dans son travail
- Compromettre la santé de la victime
Tous ces comportements entraînent des conséquences différentes selon la personnalité de la victime et le contexte professionnel.
Comment construire une prévention du risque de harcèlement moral ?
Une approche essentiellement juridique des relations au travail ou une focalisation sur des personnalités difficiles serait insuffisante.
Créer un collectif solidaire et développer le dialogue social s'avèrent les instruments de la prévention.
Un dispositif de prévention : écoute des salariés, suivi des tableaux de bord sociaux, traitement des informations régulières relayées au sein des services.
Les facteurs à prendre en compte : l'erreur serait de considérer le harcèlement moral comme une pathologie clinique : la perversion, et de se focaliser sur une approche essentiellement psychologique.
Dans l'analyse d'une situation professionnelle, l'INRS[1] rappelle cinq catégories de facteurs à prendre en compte :
Facteurs liés à la tâche (charge de travail, autonomie...)
Facteurs liés à l'organisation du travail (rythmes, horaires, missions...)
Facteurs psychosociaux liés aux relations de travail (style de management, reconnaissance, solidarité...)
Facteurs liés à l'environnement physique et technique (poste de travail, bruit, température)
Facteurs liés à l'environnement socio-économique (incertitude sur l'avenir, compression d'effectifs...)
Dossier INRS : le harcèlement moral
- Voir la jurisprudence dans la partie juridique de ce guide.
Section 3 : La violence au travail
La violence peut être physique ou verbale, morale ou psychologique. Elle est de plus en plus présente dans les entreprises.
La source en est soit externe pour celles qui reçoivent du public soit interne.
Ces violences ont souvent sur la victime un fort retentissement psychologique
3.1 Définitions de l'INRS
Selon l'INRS, on peut distinguer trois niveaux d'agression :
L'incivilité : qui relève de l'absence de respect d'autrui et se manifeste par des comportements relativement bénins, dans l'intonation ou le comportement ;
L'agressivité physique ou verbale : volonté de blesser l'autre par des menaces ou des insultes, etc.
L'agression : volonté de détruire l'autre : bousculades, coups, blessures, etc.
Escalade de la violence - questionne sur un ton sarcastique. - manifeste son désaccord. - proteste, blâme, jure. - menace, hausse le ton. - frappe, bouscule, brise. |
« Les violences au travail ont des répercussions particulièrement douloureuses dans le cadre du travail. Les larmes et la colère sont les manifestations régulièrement observées et une fissure dans le lien que le salarié entretient avec son travail.
Si aucune mesure d'accompagnement n'est prise, le salarié développe un sentiment d'abandon et l'entrée dans un processus d'épuisement professionnel se note par des attitudes de retrait progressif, un désengagement professionnel.
Laissée à sa propre destinée, une agression peut entraîner des symptômes invalidants : sentiment d'insécurité qui provoque des réactions socialement non adaptées (irritabilité, comportements agressifs, attitudes de retrait : demande de changement de poste, arrêt de travail...), comportements addictifs... (Source : revue Perfomances n°30)
Le Conseil économique et social, fait également référence à cet aspect des risques psycho-sociaux dans son rapport, « sans nier les nécessités de la procédure pénale (il) estime souhaitable d'améliorer la qualité des rapports humains et, d'une façon générale, l'accueil des victimes par les services concernés.
Cette amélioration ne passe pas seulement par la transmission d'une information claire et précise sur les procédures en cours. Il estime, par exemple, indispensable que le salarié victime d'une agression soit tenu au courant des suites réservées à la plainte déposée. »
AVIS adopté par le Conseil économique et social au cours de sa séance du 24 novembre 1999.
3.1.1 Violences externes
Ce sont des insultes ou des menaces ou des agressions physiques ou psychologiques exercées contre une personne sur son lieu de travail par des personnes extérieures à l'entreprise, y compris les clients et qui mettent en péril sa santé, sa sécurité ou son bien-être.
3.1.2 Violences internes
Elles concernent les agressions physiques ou verbales, les insultes, les brimades, les intimidations, les conflits exacerbés entre collègues, ou avec les responsables hiérarchiques.
A la différence d'une agression, les violences internes n'ont pas toujours de visibilité. Il est parfois difficile de noter la date d'un événement particulier.
Cependant, les effets observés sur les salariés sont les mêmes : sentiment de culpabilité et de honte, perte de confiance en soi et en ses compétences professionnelles, attitudes de retrait vis-à-vis du monde du travail.
Les violences internes se déploient essentiellement dans les structures de travail sans solidarité collective. Elles incluent les situations de harcèlement moral et sexuel.
Les prévenir c'est écouter la parole du salarié qui, même s'il utilise abusivement le terme de « harcèlement moral » traduit une souffrance au travail qui peut entraîner une dégradation de son état de santé et du climat social de l'entreprise.
Dossier INRS : La violence au travail
Section 4 - Les TMS
Les TMS[2], troubles musculo-squelettiques proviennent d'une combinaison de risques : des sollicitations biomécaniques dues à des mouvements répétitifs mais aussi un manque de soutien social ou une insatisfaction dans le travail.
Les articulations les plus touchées sont les membres supérieurs (poignets, coudes, épaules, dos).
Les pathologies les plus fréquentes : les tendinites des membres supérieurs, le syndrome du canal carpien, les cervicalgies et lombalgies.
« Les TMS[2] sont dus à divers facteurs de risque parmi lesquels les facteurs professionnels occupent une place importante. Ils concernent la forte répétitivité des gestes, les efforts excessifs, les postures inconfortables ou maintenues durant de longues périodes. Ils sont aussi liés à l'organisation du travail et à la perception négative du contexte de travail, par exemple le manque de soutien, l'état de stress lié au travail... Certains facteurs individuels tels que le vieillissement, des antécédents de fracture ou de diabète peuvent également intervenir dans la survenue des TMS ».
Dossier INRS : les TMS du membre supérieur
Les facteurs de risques de TMS :
Biomécaniques (répétitivité, mauvaise posture...)
Psychosociaux (manque d'autonomie, contrôles, stress...)
Physiologiques (âge, fatigue...)
Organisationnels (temps de récupération insuffisant...)
La prévention des TMS :
La prévention des risques de troubles musculo-squelettiques est particulièrement complexe et cette complexité explique en partie les difficultés rencontrées, liées :
à la multiplicité des facteurs de risque a priori (biomécaniques, organisationnels...), en lien avec l'état des personnes,
aux possibles combinaisons de ces facteurs de risques dans les situations d'exposition,
à la latence entre des modes et durées d'exposition et leurs effets sur la santé,
à la capacité à objectiver les facteurs psychosociaux, et à les intégrer dans des modèles explicatifs suffisamment proches des situations particulières pour qu'ils soient opérationnels.
Études et documents ANACT : les conditions d'une prévention durable des TMS
les conditions d'une prévention durable des TMS
Section 5 : Les risques liés à l'âge : la question des séniors
Deux points significatifs émergent des travaux d'experts de disciplines variées sur la thématique du vieillissement (sociologues, médecins du travail, psychologues du travail, ergonomes...) :
Aucun lien évident n'a pu être établi entre l'âge et la performance. Les salariés âgés développent des stratégies de compensation qui, lorsque les conditions leur permettent de les mettre en œuvre, donnent des résultats comparables en termes d'efficacité entre jeunes et anciens. Le vieillissement n'est donc pas synonyme de déclin inexorable ; pour autant il doit être pris en compte dans les modes de management et d'organisation, et de gestion des ressources humaines.
Les salariés âgés ne constituent pas un bloc homogène, les différences inter-individuelles sont beaucoup plus importantes entre deux salariés de 50 ans qu'entre un salarié de 50 ans et un salarié de 30 ans, essentiellement en raison de sa trajectoire personnelle.
La question relative à l'âge est donc relativement complexe. En effet, au delà des facteurs physiques, l'âge est une construction sociale et donc une donnée relative sur laquelle les représentations sociales pèsent très fortement. Certaines de ces représentations sont négatives : résistance aux changements, difficultés d'apprentissage, désengagement, coût excessif...
Ces représentations se sont couplées, plus particulièrement en France, avec une politique de gestion des emplois qui a favorisé durant de nombreuses années des mesures de cessation anticipée d'activité.
De fait, 50 % des personnes en arrêt de travail ont plus de 55 ans et le taux d'emploi des plus de 50 ans est de 37 % actuellement en France contre une moyenne européenne de 45 %.
Plus qu'un risque psychosocial spécifique aux séniors, c'est la question de la gestion des conditions de travail à travers les âges avec un objectif d'anticipation des problèmes de santé qui est posée.
La problématique est notamment d'éviter le risque d'exclusion en dernière partie de carrière en favorisant l'évolution constante des compétences.
L'inadéquation avec les performances attendues provoque chez les salariés un sentiment d'incompétence voire d'échec, générant un stress qui s'il persiste crée un risque d'accident ou de maladie et par la suite une inaptitude au travail.
Pour éviter que nombre de salariés de plus de 50 ans ne se retrouvent en incapacité de travail, il est nécessaire d'intégrer la question des âges très tôt dans les parcours de carrière, d'anticiper l'obsolescence des compétences en réfléchissant aux évolutions probables à 5, 10 ou 15 ans et d'avoir recours aux outils tels les bilans de carrière ou de compétences, les valorisations d'expérience et les formations en fonction de critères d'aptitude définis par nature de métiers.
La capacité à faire face au changement dépend des activités passées car ce serait le phénomène de sclérose qui rend difficile les adaptations aux nouveaux contextes professionnels, aux évolutions technologiques ou aux relations avec un public de plus en plus exigeant et informé de ses droits.
Plus que le stress, le senior rencontre la souffrance par rapport à la non reconnaissance et c'est un des plans sur lequel se place la prévention.
L'enquête 2008 Ifop/malakoff médéric révèle que parmi les principales causes de troubles psychologiques au travail perçues par les salariés, le manque de reconnaissance arrive en première position, tandis que pour le DRH, le principal obstacle à la prévention du mal-être au travail est la difficulté de faire un diagnostic de la situation.
Le RH et le manager de proximité font partie des rouages importants d'une politique préventive des risques psychosociaux et des mesures qui vont favoriser le maintien dans l'emploi des seniors en étant à l'écoute des collaborateurs qui expriment leur mal-être, leurs difficultés ou en observant les changements de comportements collectifs et individuels (repli sur soi, conflits ou irritabilité), en partageant certains indicateurs d'alerte avec le médecin du travail (baisse de productivité, absentéisme répété, agressivité), en accompagnant les personnes qui reprennent leur activité professionnelle après plusieurs mois d'arrêt de travail pour raison de santé... enfin en intégrant dans les EAEA la connaissance des facteurs de risques psychosociaux et l'évaluation du bien être de l'équipe tout autant que sa productivité, les deux étant liés.
Une gestion anticipée du risque d'inaptitude pour les salariés vieillissants apparaît nécessaire par des actions de formation, de définition de parcours de mobilité et d'adaptation des postes de travail aux salariés.
Dans ce schéma d'anticipation et de gestion du risque, il peut être fait appel aux conseil des antennes régionales de l'ANACT dont l'une des priorités fixées par l'état est la gestion des âges.
Section 6 : Les risques routiers
6.1 Le risque routier est un risque professionnel spécifique.
Les accidents routiers de trajet (déplacements domicile travail) ont représenté en 2007 13 % du montant des indemnités journalières versées par la branche AT/MP au titre des accidents du travail, soit 220 millions d'euros pour un nombre total de plus de 5 millions de journées perdues.
Le dossier de l'INRS est consultable sur son site « Prévenir le risque routier en mission »
Conduire est un acte de travail, notamment lors de déplacements professionnels dans le cadre des missions confiées. Mais prendre la route n'est pas sans risques : les accidents routiers de mission sont à l'origine de 25 % des accidents mortels du travail.
L'accident de la route en mission n'est pas une fatalité si l'entreprise met en place des mesures de prévention adaptées. Ce dossier présente l'action conduite au niveau national, les outils élaborés par l'Institution de prévention ainsi que des pistes opérationnelles de prévention pour les entreprises.
Le risque routier devient au niveau national, un des objectifs prioritaires de la prévention aux côtés des TMS. La conduite pendant un déplacement professionnel est considérée comme un acte de travail et le véhicule, utilisé dans un cadre professionnel comme un équipement de travail. La gestion du risque trajet est une problématique de plus en plus prise au sérieux et géré comme les autres risques professionnels.
Liée à la thématique du développement durable, les entreprises sensibilisent leurs collaborateurs, encouragent le covoiturage et tentent de privilégier les modes de transports collectifs comme la mise en place de plans de déplacements d'entreprise (PDE). Le nouveau « Cahier de la prévention des risques routiers » de l'Observatoire du véhicule d'entreprise, vise à aider les entreprises à mettre des PDE en place.
Augmenter l'usage des transports en commun, développer le covoiturage et organiser des formations à la conduite constituent les principales actions de prévention des risques routiers lorsque que ne sont pas mis en place des outils de vidéo-transmission et de vidéo réunion ou le télétravail qui réduisent les déplacements.
6.2 Expériences d'entreprises et bonnes pratiques
Diverses entreprises ont déjà engagé des réflexions et certaines expérimentations, deux exemples vous sont ici présentés :
SODEBO (entreprise vendéenne d'agro-alimentaire réfléchit, à la création, dans l'enceinte de l'entreprise d'une station d'auto-contrôle de l'état des pneumatiques des véhicules et travaille sur les quatre volets recommandés par la CNAMTS[4] : management des déplacements, des communications (interdiction, spécifiée dans le contrat de travail, d'utiliser son téléphone portable en conduisant), des compétences (formations à la conduite), des véhicules (politique d'entretien de la flotte d'entreprise).
L’association PSRE (Promotion et suivi de la sécurité routière en entreprise) a lancé dans six bassins d’emploi le projet 50Cinq qui vise à réduire de 50% en cinq ans les accidents avec arrêt de travail liés à la route. La première expérimentation est menée dans la région de Saint-Nazaire. La CRAM fait partie du comité de pilotage. La première étape de diagnostic menée grâce à une enquête effectuée auprès des salariés a permis de relever les points dangereux du trajet domicile travail et de définir trois axes d’intervention : infrastructures, covoiturage, sensibilisation aux comportement accidentogènes. Plusieurs entreprises du bassin d’emploi ont organisé des formations à la conduite sécurisée, des pistes cyclables ont été réhabilitées par la commune et un rond-point sera créé dans un carrefour dangereux. L’agglomération de la Carène a lancé un covoiturage d’entreprises et une nouvelle ligne de bus devrait améliorer les transports en commun.L’expérience 50Cinq sur le bassin de Saint-Nazaire a permis de réduire les accidents de 28 % entre 2002 et 2007. (Entreprise & Carrières n° 913 du 24 au 30 juin 208).
Section 7 : Le suicide en milieu professionnel
Les cas de suicides de salariés sur leur lieu de travail ou ceux dont les causes professionnelles sont avérées par les tribunaux (PSA, EDF, le Techno Centre de Renault ou La Poste) posent la question de la responsabilité des employeurs.
Il est à noter que les mesures généralement adoptées par les entreprises s'orientent essentiellement autour du management de proximité : on assiste à un « recentrage du management sur les hommes et non plus exclusivement sur les projets ». (RH & H n°24 – janvier 2007)
Les principales mesures du plan d'action chez Renault :
Renforcement du management des équipes,
Amélioration des conditions de vie au travail,
Optimisation de la gestion des compétences,
Meilleure planification de la charge de travail,
Mise en place de nouvelles ressources.
Les principales mesures du plan d'action chez EDF :
Création d'un observatoire de la qualité de vie au travail
Renforcement du dispositif éthique
Mise à disposition des salariés d'une ligne téléphonique d'écoute
Amélioration du management de proximité.
PSA Peugeot Citroën a mis en place des « cellules de veille » pour les « personnes en détresse ».
Pour Michel Debout (psychiatre, professeur de médecine légale, Vice-président de la section travail au conseil économique et social) qui préside l'Union nationale pour la prévention du suicide (UNPS), « le lien entre suicide et travail apparaît souvent comme une évidence même si la personne rencontre des difficultés personnelles qui jouent également un rôle important (rupture dans un couple, deuil, sur-endettement...) dans le passage à l'acte. »
Entreprise&Carrière n° 861 du 12 au 18 juin 2007.
Pour Philippe DAVEZIES, maître de conférences en médecine du travail à l'Université de Lyon « Cette intensification du travail qui frappe l'ensemble des secteurs, privé comme public, se traduit par des pathologies de sur sollicitation. Les troubles musculo-squelettiques, dont le nombre a littéralement explosé ces dernières années, sont les plus connus, mais on peut citer également le surmenage ou l'épuisement professionnel.
Seconde évolution forte à mes yeux : l'explosion de la souffrance psychique. Il y a la montée, chez les salariés, d'un sentiment d'absurdité. Avec un décalage croissant entre le discours sur la communication, la capacité d'initiative, la mobilisation de l'intelligence et des décisions sur le terrain qui vont à l'encontre de l'efficacité recherchée. Des cadres sont incapables d'expliquer la cohérence des réformes. Beaucoup de salariés ne savent plus ce qu'est un travail de qualité, ou ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il y a une perte de repères communs qui engendre une souffrance. Souffrance qui peut déboucher sur des troubles du comportement, la prise de médicaments, mais également sur des troubles psychiques, voire des suicides. Cette perte de repère laisse la porte ouverte à des comportements inquiétants qui relèvent de la perversion, du harcèlement. »
Extrait d'une interview réalisée en 1999 – Ph. Davezies
Pour Jean-Pierre Le Goff, Sociologue et chercheur au CNRS, les outils d'évaluation de la performance, parfois mal expliqués ou mal appliqués, combiné au « modèle de la performance sans faille », modèle qui relève du fantasme, peuvent générer une blessure narcissique profonde en cas d'échec, car c'est l'ensemble de la personnalité qui est alors remise en cause.
- INRS
Institut Nationale de Recherche et de Sécurité
- TMS
Troubles Musculo-Squelettiques
- ANACT
Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail
- CNAMTS
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés


